En commençant le dernier Michael Connelly, je réalise que je n’ai pas lu de roman policier depuis des mois (sauf peut-être un ou deux J.B. Pouy, mais est-ce vraiment du policier ?) alors que j’étais une lectrice assidue de ce genre. Il faut dire que le marché du policier s’est transformé en quelques années. D’un genre plutôt masculin et mal vu, il est devenu féminin (je parle du lectorat), en vogue, protéiforme et pléthorique, passant de 500 titres publiés en 1994 à 1300 en 2004 !
Pour ma part j’apprécie trois genres de policiers (pas mal, non ?)
- Le " polar " pur et dur, bien noir, plutôt urbain, avec une intrigue classique et un détective ou un policier consistants qui cherchent non pas un coupable mais la vérité. La société, et ce qu’elle produit, est décrite sans complaisance et les faux-semblants y sont violemment dénoncés. C’est une peinture sombre de la vie actuelle qui ressort de ce genre de romans.
 Les Américains y excellent (voir Chandler, Hammett,...), avec notamment Michael Connelly (son personnage de flic, Harry Bosch, ancien du Vietnam, qui essaie de remettre de l’ordre dans le désordre de la société, est inoubliable), Lawrence Block (avec Matt Scudder, détective privé, ancien flic, assidu aux réunions des Alcooliques Anonymes, et dans la même veine de Harry Bosch) et Ed McBain (la vie quotidienne d’un commissariat à Los Angeles). Dennis Lehane, quant à lui, mêle avec succès polars noirs et thrillers.
Les Américains y excellent (voir Chandler, Hammett,...), avec notamment Michael Connelly (son personnage de flic, Harry Bosch, ancien du Vietnam, qui essaie de remettre de l’ordre dans le désordre de la société, est inoubliable), Lawrence Block (avec Matt Scudder, détective privé, ancien flic, assidu aux réunions des Alcooliques Anonymes, et dans la même veine de Harry Bosch) et Ed McBain (la vie quotidienne d’un commissariat à Los Angeles). Dennis Lehane, quant à lui, mêle avec succès polars noirs et thrillers.
- le " polar social " qui descend plutôt du " néo-polar gauchiste " de Manchette.
Les auteurs : Pouy, Oppel, Marc Villard, Daeninckx, Izzo.
Les sujets : la vie quotidienne aujourd’hui et souvent les liens avec un passé " qui ne passe pas " ou avec une réalité fortement marquée par les difficultés sociales et politiques. C’est le roman-témoignage d’aujourd’hui.
- le " polar ethnologique " quand il est à la hauteur d’un Upfield ou d’un Hillermann. Ou historique avec les Cadfael ou les Juge Ti. Mais je trouve que la multiplication des séries historiques a bien affadi le genre…
Quant aux thrillers, le genre qui se développe le plus, ….. je n’aime pas avoir peur, alors…..Et le polar régionaliste, bof…
Bref, si l’on compte à peu près un Connelly tous les deux ans, un Lawrence Block (avec Matt Scudder) tous les deux ou trois ans, quelques polars français et quelques bonnes surprises dans le polar étranger (scandinave et autre), çà fait en effet nettement baisser le rythme…..
 Dans ce récit, il nous présente une sorte de journal tenu pendant un an autour d’une dizaine de livres qu’il s’est proposé de relire. Ne vous découragez pas si certains auteurs ne vous disent rien de rien (Sei Shonagôn, Kenneth Grahame ???), vous connaissez certainement les autres (Châteaubriand, Kipling, Wells, Buzzati,…). De toutes façons ce n’est pas une explication de texte mais une promenade de Manguel chez quelques auteurs auxquels il associe les événements de sa vie quotidienne.
Dans ce récit, il nous présente une sorte de journal tenu pendant un an autour d’une dizaine de livres qu’il s’est proposé de relire. Ne vous découragez pas si certains auteurs ne vous disent rien de rien (Sei Shonagôn, Kenneth Grahame ???), vous connaissez certainement les autres (Châteaubriand, Kipling, Wells, Buzzati,…). De toutes façons ce n’est pas une explication de texte mais une promenade de Manguel chez quelques auteurs auxquels il associe les événements de sa vie quotidienne.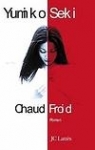 Ayant eu la chance de lire les auteurs français pendant son adolescence, Yuka a toujours aimé la culture française et souhaité venir en France. En effet, dans le Japon des années soixante-dix, les filles sont encore soumises au modèle traditionnel, les relations avec les garçons sont rares et même les sorties pendant l’adolescence sont difficiles à faire admettre par les parents. Yuko étouffe dans ce carcan et c’est bien maladroitement qu’elle essaie d’en sortir. La fréquentation des bars et des boîtes, les relations sexuelles occasionnelles et, pour finir, une sévère anorexie, la mettront au ban de ses amis. La proposition d’une Bourse d’études pour Paris sera l’occasion rêvée de sortir de ce cercle infernal.
Ayant eu la chance de lire les auteurs français pendant son adolescence, Yuka a toujours aimé la culture française et souhaité venir en France. En effet, dans le Japon des années soixante-dix, les filles sont encore soumises au modèle traditionnel, les relations avec les garçons sont rares et même les sorties pendant l’adolescence sont difficiles à faire admettre par les parents. Yuko étouffe dans ce carcan et c’est bien maladroitement qu’elle essaie d’en sortir. La fréquentation des bars et des boîtes, les relations sexuelles occasionnelles et, pour finir, une sévère anorexie, la mettront au ban de ses amis. La proposition d’une Bourse d’études pour Paris sera l’occasion rêvée de sortir de ce cercle infernal. Téhéran quelques mois avant la Révolution islamique. L’atmosphère n’a jamais été aussi tendue que pendant cette fin de règne du Shah et la montée rapide de l’islamisme. Les étudiants essaient de se passionner pour la littérature ou le théâtre alors que la tragédie se joue sous leurs fenêtres. Pourtant les passions amoureuses se développent sur fond d’inquiétude et de projet de départ à l’étranger. Niloufar et Mithra, égéries de Kamran, Nader et Isamïl, interprètent Tchékhov…
Téhéran quelques mois avant la Révolution islamique. L’atmosphère n’a jamais été aussi tendue que pendant cette fin de règne du Shah et la montée rapide de l’islamisme. Les étudiants essaient de se passionner pour la littérature ou le théâtre alors que la tragédie se joue sous leurs fenêtres. Pourtant les passions amoureuses se développent sur fond d’inquiétude et de projet de départ à l’étranger. Niloufar et Mithra, égéries de Kamran, Nader et Isamïl, interprètent Tchékhov… C’est toujours un plaisir de découvrir un nouveau livre de Mingarelli. On sait que l’on va y trouver des personnages seuls avec eux-mêmes dans une atmosphère intemporelle et fascinante.
C’est toujours un plaisir de découvrir un nouveau livre de Mingarelli. On sait que l’on va y trouver des personnages seuls avec eux-mêmes dans une atmosphère intemporelle et fascinante.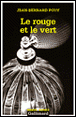 Dans un dîner mondain, Adrien, "nez" chez un parfumeur, essaie d’être à la hauteur de la discussion ambiante (que des universitaires et des sociologues ! ) et se targue d’être spécialiste en roman policier. Un des chercheurs lui propose illico, moyennant finances, de faire ce qui n’a encore jamais été fait dans le polar : enquêter sur rien, comme çà, au hasard. Adrien se transforme donc en détective amateur et rend chaque semaine sa copie d’enquêteur…. du "rien"… Ou plutôt du "tout", car si on cherche des mystères dans la vie quotidienne, on en trouve, et pas forcément des plus avouables !
Dans un dîner mondain, Adrien, "nez" chez un parfumeur, essaie d’être à la hauteur de la discussion ambiante (que des universitaires et des sociologues ! ) et se targue d’être spécialiste en roman policier. Un des chercheurs lui propose illico, moyennant finances, de faire ce qui n’a encore jamais été fait dans le polar : enquêter sur rien, comme çà, au hasard. Adrien se transforme donc en détective amateur et rend chaque semaine sa copie d’enquêteur…. du "rien"… Ou plutôt du "tout", car si on cherche des mystères dans la vie quotidienne, on en trouve, et pas forcément des plus avouables !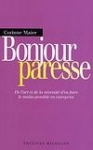 Si vous travaillez dans une entreprise, que vous êtes "hyper motivé", que vous faites confiance à vos managers, et que vous pensez que les NTIC, la culture d’entreprise et l’éthique sont des priorités pour les années à venir, ne lisez pas ce livre…
Si vous travaillez dans une entreprise, que vous êtes "hyper motivé", que vous faites confiance à vos managers, et que vous pensez que les NTIC, la culture d’entreprise et l’éthique sont des priorités pour les années à venir, ne lisez pas ce livre…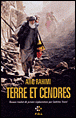
 Dans un village africain, l’eau vient à manquer. Pour survivre, les habitants n’ont pas d’autres solutions que partir dans le désert en direction d’improbables puits encore en activité. Faut-il partir vers le Sud ou vers l’Est ? Rahne, l’instituteur, a étudié la carte et choisit le Sud, avec sa famille et celle de son meilleur ami, et avec la fidèle Chamelle. Mais le premier puits est asséché, le deuxième est pris d’assaut et gardé par les soldats, et pour aller plus loin il faudra payer de la vie de certains. Rahne devra à la fois se battre pour continuer et essayer de trouver enfin un peu d’eau, et aussi accepter les malheurs que cette sécheresse apporte.
Dans un village africain, l’eau vient à manquer. Pour survivre, les habitants n’ont pas d’autres solutions que partir dans le désert en direction d’improbables puits encore en activité. Faut-il partir vers le Sud ou vers l’Est ? Rahne, l’instituteur, a étudié la carte et choisit le Sud, avec sa famille et celle de son meilleur ami, et avec la fidèle Chamelle. Mais le premier puits est asséché, le deuxième est pris d’assaut et gardé par les soldats, et pour aller plus loin il faudra payer de la vie de certains. Rahne devra à la fois se battre pour continuer et essayer de trouver enfin un peu d’eau, et aussi accepter les malheurs que cette sécheresse apporte. Je dois être à peu près la trois millième à comparer ce livre avec "Persépolis" de Maryane Satrapi, mais c’est vrai que c’est tentant. Dans les deux ouvrages c’est la situation en Iran qui est vue par les yeux d’une collégienne.
Je dois être à peu près la trois millième à comparer ce livre avec "Persépolis" de Maryane Satrapi, mais c’est vrai que c’est tentant. Dans les deux ouvrages c’est la situation en Iran qui est vue par les yeux d’une collégienne.